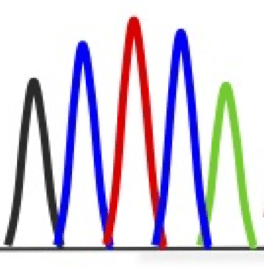Anomalies oculaires congénitales multiples (MCOA), liées à PMEL
Gène impliqué : PMEL
Mode de transmission : Autosomique, co-dominant (pénétration incomplète)
Pour une maladie génétique autosomique dominante, un animal doit avoir au moins une copie de la mutation en question pour être à risque de développer la maladie. Les animaux avec deux copies de la mutation présentent généralement des symptômes plus sévères et un début précoce de la maladie que les animaux avec une seule copie de la mutation. Un ou les deux parents d’un animal porteur de la mutation ont une ou deux copies de la mutation. Les animaux qui ont une ou deux copies de la mutation peuvent transmettre la mutation à leur descendance. Alternativement, la maladie est le résultat d’une mutation de novo.
Mutation : Substitution, gène PMEL ; c.1849 C>T, p.(Arg618Cys), exon11, chromosome 6.
Races : American Miniature horse, Ardennes horse, Contois horse, Icelandic horse, Kentucky Mountain Saddle, Missouri Fox Trotter, Morgan, Rocky Mountain horse, Shetland Pony
Système médical : Oculaire, cutané.
Âge d’apparition des signes cliniques : À la naissance.
Le syndrome des anomalies oculaires congénitales multiples (MCOA) chez le cheval est causé par la même mutation du gène PMEL responsable du phénotype argenté/dapple. Le gène PMEL code une protéine essentielle au fonctionnement normal des mélanosomes au sein des mélanocytes. Une mutation dans le gène PMEL, connue sous le nom de locus « Z », est responsable de la couleur de la robe argentée/dapple. Cette mutation présente avec une génétique autosomique dominante dans les races de chevaux qui permettent ce modèle de pigmentation. La mutation du locus Z est pléiotrope, car elle est également responsable des anomalies oculaires observées dans le cas de l’MCOA. Pour ces anomalies oculaires, la mutation présente désormais un mode génétique codominant. L’animal hétérozygote (porteur) peut présenter des anomalies oculaires légères, notamment des kystes au niveau de l’iris, du corps ciliaire et de la rétine, ou peut être asymptomatique. L’animal homozygote doublement mutant peut présenter un large éventail de défauts oculaires plus graves, notamment des kystes, des cataractes, un glaucome, et des anomalies cornéennes et iriennes. Les races de chevaux ne présentant pas de pigmentation argentée/pommelée ne sont pas sensibles à l’MCOA. Des tests ADN doivent être utilisés pour identifier la présence du locus Z chez le cheval alezan (et le potentiel du MCOA), chez lequel la pigmentation argentée/dapple n’est pas évident.
Il est à noter que les mutations du gène PMEL sont responsables du phénotype de pigmentation merle observé chez le chien, qui peut également être associé à des effets pléiotropes, notamment la microphtalmie et la surdité.
Références :
Liens OMIA : [0733-9796], [1438-9796]
Mowat FM, Iwabe S, Aguirre GD, Petersen-Jones SM. (2024) Consensus guidelines for nomenclature of companion animal inherited retinal disorders. Vet Ophthalmol 28:663-667. [pubmed/38334230]
Herb VM, Zehetner V, Blohm O. (2021) Multiple congenital ocular anomalies in a silver coat Missouri Fox Trotter stallion. Tierarztl Prax Ausg G Grosstiere Nutztiere 49:350-354. [pm/34666370]
Andersson LS, Wilbe M, Viluma A, et al. (2013) Equine multiple congenital ocular anomalies and silver coat colour result from the pleiotropic effects of mutant PMEL. PLoS One 8:e75639. [pm/24086599]
Ségard EM, Depecker MC, Lang J, et al. (2013) Ultrasonographic features of PMEL17 (Silver) mutant gene-associated multiple congenital ocular anomalies (MCOA) in Comtois and Rocky Mountain horses. Vet Ophthalmol 16:429-35. [pm/23278951]
Andersson LS, Axelsson J, Dubielzig RR, et al. (2011) Multiple Congenital Ocular Anomalies in Icelandic horses. BMC Vet Res 7:21. [pm/21615585]
Brunberg E, Andersson L, Cothran G, et al. (2006) A missense mutation in PMEL17 is associated with the Silver coat color in the horse. BMC Genetics 7:46. [pm/17029645]
Ramsey DT, Ewart SL, Render JA, et al. (1999) Congenital ocular abnormalities of Rocky Mountain Horses. Vet Ophthalmol 2:47-59. [pm/11397242]
Contribué par : Sandrine Jobin et Rose Laflamme, promotion de 2029, Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal.